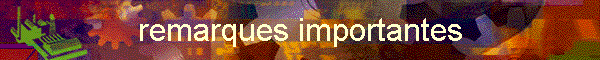

|
|
|
ici un ouvrage en traductologie Chapitre1 repérage linguistique coordonnées d'un élément linguistique remarques importantes chapitre2 définition préliminaire traduction encodage-décodage définition sémiotique de traduction classifications en traduction chapitre3 équations en traduction : équation syntagmatique équation paradigmatique équation sémantique équation temporelle . La société et choix des mots chapitre4 Le terme métatraduction : un néologisme née au Maroc en 2003 chapitre7 Exercices en traduction : une vingtaine de modèles parfaitement ajustés à notre théorie Introduction à la partie pratique des fondements théoriques مــــقدمـــة الجزء التطبيقي من الأسس النظرية للترجمة العلمية Unités syntagmatiques simples وحدات تركيبية بسيطة Unités syntagmatiques complexesوحدات تركيبية مركبة Textes scientifiques vulgariséesنصوص علمية معممة Textes généraux:traductions sans commentaires : ترجمة دون تعلـــــيق نصـــــــــــــوص عــــامـــة
|
III-Remarques importantes : 1) Au
cours de la détermination des coordonnées syntagmatiques,
on se contentera de
l’analyse grammaticale du premier niveau . Quant à l’analyse logique de
deuxième degré , il pourrait être utilisé au niveau morpho-lexical :
par exemple, une énoncé comme « Un
moteur de puissance très grande consomme
une grande quantité de
gasoil » aura pour coordonnée syntagmatique : Sax=S+Vt+COD
, et le groupe nominal sujet : « Un moteur de puissance très grande » aura, au niveau
morpho-lexical la coordonnée : n.m+[CDN+Adj]. En
langue arabe, ce n’est pas la peine de prêter grande attention à l’analyse
flexionnelle qui est fonction de ce qu’on appelle la théorie d’
« al ‘āmil » ou la « théorie d’actant » :
dans ce cadre, le verbe est un « actant » étant donné qu’il met
le nom-sujet ou attribut au cas nominatif(arraf ‘) (Cas exprimant la fonction grammaticale
de sujet ou d'attribut dans les langues à déclinaison comme l’Arabe) ,
et il met le nom-complément d’objet direct au cas direct(annaŠb) ;
La préposition est un « actant » vu qu’elle met le
nom-complément d’objet indirect(COI) ou complément circonstanciel (CC) au
cas génétif(aljar) ; le verbe défectif « kāna » est
actant, car il met le sujet au cas nominatif et l’attribut au cas direct ;
l’entité négative « lam » est actant , car elle met le verbe au
cas apocope(aljazm)… Les
grammairiens arabes s’attachent trop , de ce fait, aux structures purement
formelles , alors qu’ils devraient réaliser cette transition spécifique
faisant virer la pensée humaine de l’élément purement linguistique à son référent
extralinguistique(2[h1]).
D’ailleurs, on ne comprend pas comment le verbe , qui ne représente que
l’action, est considéré comme actant. En réalité, c’est le sujet qui est
l’actant , car c’est lui qui a fait l’action . A la rigueur, on
pourrait dire que le verbe , par exemple, est un actant grammatical. Les
grammairiens français ont, eux aussi, été confrontés à de telles problématiques,
mais ils les ont traitées avec plus d’objectivité :
on trouve ainsi dans « A la découverte de notre langue » (cf.
André Hinard et Christine Lamotte 1989 :160) le texte suivant : «
Soit la phrase suivante :
il manque deux cartes Dans
cette phrase, le pronom il entraîne
l’accord du verbe manque : il est sujet. Mais le verbe est suivi
d’un groupe nominal deux cartes qui, du point de vue du sens, apparaît
comme le véritable sujet( comparez : deux cartes manquent). Il est dit
sujet grammatical(s.), deux cartes sujet logique (S.). Le verbe manque est construit impersonnellement. -
Construction personnelle :
-
Construction impersonnelle :
Si, cette bonne mise en scène prise en charge, on aurait dû nommé la
théorie d’actant , théorie d’actant grammatical et notre propos présupposerait
la présence d’un autre type d’actant, à savoir, l’actant réel ou
l’actant « logique », bien que, à mon sens, le qualificatif « logique » doit être utilisé
avec de grandes précautions ; car la grammaire ne peut jamais être
exclue du cadre logique… 2)
Il existe une quatrième dimension du texte : la dimension
temporelle. Ce sujet sera traité dans les chapitres suivants , précisément
lors de l’étude de l’équation temporelle. 3)
On doit absolument avoir une compétence d’un repérage
distinctif qui nous permettra de distinguer ,dans une phrase, les parties
principales des compléments : ainsi les constituants suivants, dans une
phrase verbale arabe, : le verbe, le sujet, le COD , représentent la
partie principale. Il est de même pour le « sujet »(al mubtada’)
et l’attribut(al khabar) dans la
phrase nominale(al jumla al’ismiya) ; et le 1ier syntagme
restrusturé , le 2ème
syntagme restrusturé dans les phrases annexes à la phrase nominale: les
phrases nominales « transformées » , soit par des particules ( inna
et ses semblables), soit par des
verbes défectifs ( kāna et ses semblables) . Les autres constituants
tels les compléments circonstanciels, les subordonnées relatives,
complétives … sont des compléments
et de ce fait ne seront pas représentés dans la coordonnée
syntagmatique de l’énoncé.
4)
Si le texte est relativement long , devront être repérées les unités
syntagmatiques dont la résultante représente la coordonnée syntagmatique du
texte dans sa totalité. Ces unités seront ultérieurement
appelées unités de traduction. 5)
La coordonnée paradigmatique d’un texte ne se fait qu’à base
d’une sémiotique donnée ; mais cette sémiotique doit être pertinente.
Ainsi, si nous sommes en question d’un texte scientifique , le repérage de la
coordonnée paradigmatique à base de la sémiotique des termes scientifiques
appartenant au domaine cognitif du texte, sera
une opération profitable ; toutefois, d’autres repérages sont
toujours possibles. Si le texte est argumentatif, la coordonnée paradigmatique
sera bidimensionnelle : le champ lexical représentant la thèse proposée
et celui représentant la thèse refusée. Le texte descriptif
est souvent caractérisé par de nombreux champs lexicaux : le champ
lexical des sèmes constitutifs et/ou fonctionnels de l’objet décrit, le
champ lexical des qualités, le champ lexical rhétorique des analogies… Mais
une équation paradigmatique limitée à la sémiotique des termes scientifiques
est imposée par notre objectif pédagogique
, établir une première assise dans le but de parvenir à esquisser une
conception théorique pour la traduction scientifique en classes du secondaire
scientifique et technique.
D’une manière générale,
l’équation paradigmatique nécessite tout d’abord un repérage à base
d’une sémiotique donnée dans la langue de départ, ensuite sont comparés à
base d’une métatraduction les éléments repérés. 6)
Eventuellement, on peut se poser la question suivante : Comment
ce repérage linguistique , « limité » à trois dimensions, peut-il
rendre compte d’autres dimensions linguistiques, comme par exemple la
dimension rhétorique ?
Ici, nous devons absolument distinguer la pragma
tique comme usage langagier de la langue par une communauté linguistique
donnée d’une part, et la langue d’autre
part. La coordonnée rhétorique est en effet produite par le locuteur selon ses
propres visées pragmatiques. En outre, la composante rhétorique est fonction
des autres composantes :
Moi,
locuteur, je peux modifier la coordonnée syntagmatique( structure de la phrase)
pour que ma parole soit affectée d’un certain style et d’une certaine
musicalité …Je peux également modifier la coordonnée paradigmatique (sémiotiques
lexicales) en remplaçant un mot par un synonyme élégant ou une expression
pragmatiquement visée . Je peux de même procéder aux deux transformations à
la fois. Peut-être ceci dépend-il de mes propres compétences linguistiques ,
encyclopédiques … Il existe donc des dimensions extralinguistiques manipulées par le locuteur lui-même , disant des dimensions pragmatiques : je peux, en effet , en tant que locuteur, teinter mes propos d’objectivité , de subjectivité, de menace, de séduction ; mes paroles peuvent être laudatives ou péjoratives ; mon discours peut être polémique et « électrisé » comme il peut être sincère et plein de convivialité …Tout dépend de mes compétences , mes acquis , mes capacités…
Ici est offerte une bonne occasion pour détailler la relation entre la
pragmatique et la sémantique , tâche exécutée
au sein de la remarque méthodologique
suivante :
Avant de conclure ce chapitre qui a été consacré au concept de repérage
linguistique , on doit nécessairement signaler que ce sujet n’est pas
l’objet essentiel de la présente recherche , mais ne constitue en fait
qu’une introduction théorique nécessaire pour l’établissement d’une
assise théorique en traduction .
Mais , étant donné l’importance qu’il acquiert, il mérite d’être traité
indépendamment afin de pouvoir garantir un certain degré de scientificité et
d’applicabilité lui permettant de cohabiter avec les diverses théories
linguistiques en vigueur. Un projet intitulé « repérages linguistiques »
serait dans ce cadre prometteur : l’analyse textuelle ne serait dans
cette perspective qu’un ensemble complexe de repérages linguistiques auxquels
procède le lecteur par exemple. Ces repérages seront opérés à différents
niveaux linguistiques, mais le point commun sera repérer une sémiotique
particulière . On peut ainsi, au niveau structurel, repérer les structures
actives , les structures passives, les structures impersonnelles , les
structures complexes , les structures transitives , les structures
intransitives…Et au niveau lexical, on peut repérer la sémiotique des verbes
transitifs , des verbes intransitifs , des noms communs , des noms propres , des
termes scientifiques, des sèmes constitutifs , des sèmes génériques…
Une éventuelle objection me pourrait être posée au sujet de
l’appartenance du sens pragmatique au sens sémantique. La pragmatique , qui
s’occupe de la relation entre les signes linguistiques et leurs utilisateurs,
et la sémantique, qui s’occupe de la relation entre les signes linguistiques
et leurs significations dans la réalité extralinguistique, ont vécu une période
de disjonction et de répulsion :à l’époque de C W Morris(1936), le
sens avait deux dimensions
distinctes, à savoir une composante sémantique interne et une composante
pragmatique externe ; et le sens pragmatique était considéré comme
additionnel et tributaire de la situation d’énonciation … Après,
C. S. Pierce fit la distinction entre sens sémantique et sens pragmatique via
la distinction entre un signe considéré comme « type » et un signe
considéré comme « occurrence » . Il proposa ainsi « signe-type »
et « signe-occurrence » : par exemple le mot « chat »
représente un signe-occurrence lorsqu’ il apparaît en usage dans une
situation de communication concrète et bien définie spatio-temporellement . Ce
même mot sera un signe-type quand il est réputé entité abstraite hors
contexte énonciatif. De même , Pierce évoqua la notion de
« phrase-type » et de « phrase-occurrence » . Néanmoins,
cette « rupture » se trouva fortement critiquée par Bar-Hillel en
1954 . Ce dernier affirme que ,dans les langages « indexicaux »(3[h2][h3][h4])
comme les langues naturelles, la relation pragmatique des phrases et leurs
utilisateurs interfère avec la relation sémantique des phrases et des états
de choses qu’elles représentent. C’est ainsi qu’il a nommé « pragmatique » la sémantique des
langages indexicaux , et réservant la « sémantique » pour la sémantique
des langages non indexicaux comme les langages artificiels ; puis, Montague
a fait de même en 1968. Cette
conception a été par suite revue par J.L.Austin qui découvert une notion très
importante : la théorie des actes illocutionnaires . Cette théorie sera
prise comme premier fondement de notre nouvelle approche d’une
théorie de compréhension textuelle ou ce que l’on appelle la détermination
de la coordonnée sémantique. En effet, la langue est, selon Austin, une
institution qui permet l’application de ces actes illocutoires . Ainsi, si un
locuteur dit : « très beau est l’homme sincère » ,
son énoncé révèle son intention qu’est le louage de l’homme sincère…
Bref, « …Si on considère que le sens pragmatique , en tant
que sens conventionnel et en tant que sens pragmatique, ressortit à la fois à
la sémantique et à la pragmatique, il faut rejeter la thèse selon laquelle la sémantique et la pragmatique
sont deux disciplines disjointes, et admettre qu’elles se recouvrent
partiellement. » (Cf. F. RECANATI :Les énoncés performatifs .
Paris - Éditions de Minuit 1981 :28)
C’est la preuve en vertu de laquelle le sens pragmatique est parmi les
trois constituants du sens sémantique ; plus précisément il se localise
au niveau du sens contextuel.
[h1]Cette notion de référent d’un élément linguistique sera amplement détaillée dans le deuxième chapitre de cette partie théorique ; plus précisément lorsqu’on parlera de la traduction comprise comme décodage encodage. [h2] [h2](3)« Ce sont les langages incluant des expressions indexicales ou token-réflexives , c’est-à-dire les langages tels qu’on ne peut dissocier la relation sémantique du signe à l’objet et la relation pragmatique du signe à ses utilisateurs »(Cf. François RECANATI :Les énoncés performatifs . Paris Editions de Minuit 1981 :17) |
|
Envoyez un courrier électronique à halitraduire@yahoo.frpour toute question ou remarque concernant ce site
Web.
|