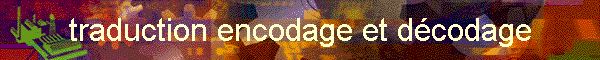

|
|
|
ici un ouvrage en traductologie Chapitre1 repérage linguistique coordonnées d'un élément linguistique remarques importantes chapitre2 définition préliminaire traduction encodage-décodage définition sémiotique de traduction classifications en traduction chapitre3 équations en traduction : équation syntagmatique équation paradigmatique équation sémantique équation temporelle . La société et choix des mots chapitre4 Le terme métatraduction : un néologisme née au Maroc en 2003 chapitre7 Exercices en traduction : une vingtaine de modèles parfaitement ajustés à notre théorie Introduction à la partie pratique des fondements théoriques مــــقدمـــة الجزء التطبيقي من الأسس النظرية للترجمة العلمية Unités syntagmatiques simples وحدات تركيبية بسيطة Unités syntagmatiques complexesوحدات تركيبية مركبة Textes scientifiques vulgariséesنصوص علمية معممة Textes généraux:traductions sans commentaires : ترجمة دون تعلـــــيق نصـــــــــــــوص عــــامـــة
|
II- Vers une nouvelle définition
de la traduction :
1-Traduction :
décodage-encodage:
C’est une définition
réputée contextuelle étant donné sa relation intime à la réalité
extralinguistique, notamment au contexte d’énonciation . Dans cette
perspective, la traduction est phénomène de décodage et d’encodage. Ø
Décodage du texte Original : C’est un opération
intellectuelle qui, à chaque élément linguistique du texte original ,
fait correspondre un référent extralinguistique appartenant à la réalité
des choses comme se le représente le décodeur.
Le décodage d’un mot comme « estomac » par un anatomiste
n’est le même que par un individu non spécialisé : le lexème se
caractérise par une infinité de sèmes qui forment le sémème ; ces sèmes
sont inhérents au référent mais le sujet décodeur(homme ou machine) n’est
capable d’identifier que les sèmes supposés connus pour lui. Par conséquent,
le sémème que peut donner un anatomiste au mot « estomac » reste
toujours incomplet, et a fortiori celui que peut donner un individu non spécialisé.
La progression de la science ne s’arrête jamais et les sèmes constitutifs
d’un objet se raffinent continuellement. On disait que les sèmes constitutifs
de l’atome sont :le noyau et les électrons ;c’est-à-dire,
d’autres sèmes attendaient l’avènement de la microscopie électronique
pour surgir. C’est le cas des protons et des neutrons et actuellement
d’autres ont marqué leur apparition. Donc le linguiste est incapable
d’épuiser tout le sémème d’un
lexème . Ainsi le sémème de M.Pottier qui attribue au lexème « chaise »
quatre sèmes : « avec dossier », « sur pieds »,
« pour s’asseoir » et « pour une seule personne »,
reste incomplet surtout s’il s’agit des sèmes constitutifs. En conclusion,
l’analyse sémique (calcul de la coordonnée sémique dans le repère
postcontextuel morpho-phonosémique) est proportionnelle au degré de spécialité
de l’interprétateur dans le domaine du référent du lexème sujet
d’analyse. Ø
Encodage : C’est
l’inverse du décodage. Les référents identifiés sont renommés dans la
langue d’arrivée , c’est-à-dire ils sont reliés à d’autres formes
linguistiques qui leur sont convenables.
L’applicabilité de cette définition aux éléments non aptes d’être
appelés texte est évidente : Par exemple :
Mais, lorsqu’il s’agit d’un texte, les choses ne marchent pas de
soit et le décodage devra se faire avec toute précaution et avec le maximum de
précision. Ainsi, il serait très nécessaire d’accorder une attention
particulière aux contextes verbaux (positions des mots au sein du texte) et aux
contextes d’énonciation. C’est-à-dire qu’il existe des mots pouvant référer,
en même temps, à de nombreuses réalités extralinguistiques . C’est le cas
notamment du phénomène de polysémie(propriété d’un signe linguistique qui
a plusieurs sens) . « Le caractère polysémique du vocabulaire général,
dit J.Dubois, a souvent été senti comme une contrainte pour la pensée
scientifique (par exemple par Leibniz). Les linguistes établissent parfois, en
revanche, une corrélation entre le développement d’une culture et
l’enrichissement polysémique des unités(M.Bréal).
La polysémie est en rapport avec la fréquence des unités : plus
une unité est fréquente et plus elle a des sens différents. G.K.Zipf a tenté
de formuler une loi rendant compte de ce rapport. On a essayé de chiffrer sa
formule sous la forme M=F.1/2, où M indique le nombre des sens de
l’unité, et F la fréquence relative de l’unité. » (
cf. J. Dubois et al.1973 :382). Mais cette formule n’est pas
validée par la communauté linguistique étant donné son rapport direct avec
l’analyse lexicale sémique dont le degré de scientificité est
malheureusement encore assez faible.
Donc, on peut , comme le suggère Antoine G. Mattar(cf. Antoine
G.Mattar 1987 :30), aux apprentis traducteurs quelques séries des
termes choisis et ayant plusieurs valeurs sémantiques. Par exemple le terme
« pièce » aura pour référent ,selon les contextes ,à un morceau
de quelque chose(ÞØÚÉ
) ou à un élément d’un appareil ou
à une chambre( ÛÑÝÉ
) ou également à une partie théâtrale( ãÓÑÍíÉ
Ãæ
ÊãËíáíÉ )
. En arabe, un mot comme ( Úíä
) pourrait dénoter un organe « œil » ou une source
d’eau.
Ce type d’obstacles ne peut être surmonté que par recours obligatoire
à une appréhension profonde de la composante contextuelle du sens global du
texte.
A ce niveau se pose une problématique sérieuse : Quel est le référent
de l’unité textuelle, ou énoncé ?
Les énoncés sont classifiés, selon les grammairiens arabes , en
trois catégories : 1.
Enoncé déclaratif informatif : « C’est
un énoncé dont le contenu sémantique peut être évalué en terme de véracité
ou de fausseté, sans prendre en considération le fait que le locuteur
soit connu comme étant sincère ou menteur. Par exemple, soient les
affirmations suivantes : « Il a plu hier » ou «
mon père vient aujourd’hui » ou « les absents viendront demain ».
Toutes ces phrases peuvent être décrites en elles-même
comme étant vraies ou
fausses et le fait que le locuteur soit dépeint de sincérité ou de mensonge
n’a rien à voir dans ce jugement. C’est ce qu’ils veulent dire par :
« La phrase informative peut être vraie ou fausse en elle-même ».
On peut ainsi évaluer un énoncé informatif de vrai ou faux
sans même se préoccuper de la loyauté ou du mensonge du locuteur »(d’après
‘ABBASS HASSAN1975 :374). La phrase déclarative (ou assertive) est
employée par le locuteur pour livrer une information, annoncer un fait :
l’interlocuteur est alors invité à prendre position par rapport à l’énoncé,
à marquer son accord ou son désaccord. Il est donc invité à évaluer l’énoncé
en terme de fausseté ou de véracité(D’après Microsoft ® Encarta ®
Collection 2003)
2.Enoncé illocutoire :
« C’est l’énoncé par lequel on demande soit la production
d’un événement ou l’interdiction de cette production, soit l’approbation
d’un autre événement ou son improbation ; l’évaluation en terme de véracité
et de fausseté est à écarter dans ce cas. »( ‘ABBASS HASSAN 1975
:375)
Un énoncé illocutoire est perçu dans une perspective de pragmatisme
illocutoire qui reprend les idées développées par Austin et Searle et nous,
de notre part, nous reprendrons ce pragmatisme illocutoire plus loin pour
illustrer un niveau important de calcul de la coordonnée sémantique(analyse
textuelle). L’hypothèse fondatrice d’un tel pragmatisme est, selon
C.K.Orecchioni(cf. C.K.Orecchioni 1980 :185) , la suivante : « Parler,
c’est sans doute échanger des informations ; mais c’est aussi
effectuer un acte, régi par des règles précises, qui prétend transformer la
situation du récepteur, et modifier son système de croyances et/ou son
attitude comportementale ; corrélativement, comprendre un énoncé c’est
identifier, outre son contenu informationnel, sa visée pragmatique, c’est-à-dire
sa valeur et sa force illocutoires. ».
O.Ducrot va jusqu’à dire que qu’un énoncé interrogatif ou impératif(deux
types d’énoncés illocutoires)transforme ipso facto la situation du
destinataire en mettant celui-ci devant une
alternance juridique inexistante auparavant : répondre ou ne pas répondre,
obéir ou désobéir.
Très importance est la déclaration de C.K.Orecchioni(Ibidem :188) que
la suivante: « Mais il ne faudrait pas croire que
seuls les énoncés de ce type, qui exigent de leur destinataire une réponse
verbale ou comportementale , sont illocutoirement chargés : tout énoncé
quel qu’il soit peut être considéré comme comportant, outre son contenu
propositionnel(correspondant à ce qui est dit), un marqueur illocutoire ,
qui peut être complexe, et doit spécifier le statut pragmatique de l’énoncé(
ce à quoi vise le dire : obtenir tel type de comportement-réponse, mais
aussi, par exemple, l’adhésion du destinataire au contenus assertés ».
C’est cette déclaration , entre autres notamment d’O.Ducrot, qui va
nous permettre, en généralisant la théorie des actes de langage, d’élaborer
une technique de dégagement d’une partie des contenus sémantiques d’un
texte. ‘Abbass Hassan,
avec lui les grammairiens arabes, subdivise les énoncés illocutoires en deux
classes : « ‘aljumal ‘al ‘inchāiya gayr ‘aţalabiya »
qui sont des énoncés dont le signification se réalise souvent dès qu’ils
sont prononcés, c’est le cas des énoncés exclamatifs, des énoncés
laudatifs ou péjoratifs, des énoncés de serment(jumal ‘alqasam), formules
des contrats commerciaux par exemples… ;« ‘aljumal‘al‘inchāiya‘aţalabiya »dont
on réclame l’accomplissement ou non d’une chose . La prononciation de tels
énoncés est antérieur à la réalisation de leur sens et entrent dans ce
cadre les énoncés interrogatifs, impératifs, d’invocation(du’ā ‘),
de défense(nahy)… (D’après ‘ABBASS HASSAN 1975 :374-375) Reposons
à nouveau la question : Que
dénote un énoncé ? Si l’énoncé est
informatif, son référent dans la réalité extralinguistique est justement sa
valeur de vérité. Ainsi, si un énoncé a été effectivement réalisé, il
sera qualifié de vrai et son locuteur est de ce fait sincère. Dans ce cas on
dirait, comme le disait d’ailleurs le philosophe d’oxford
Austin, que l’énoncé est
heureux . Mais si l’énoncé n’a pas été accompli réellement , il sera réputé
faux et il s’agit ici d’un énoncé malheureux, qui ne possède pas de référent
réalisé au niveau extralinguistique. Ce malheur de l’énoncé peut être dû au
locuteur lui même ou au récepteur. En effet, le saint discours coranique est
toujours heureux, de manière absolue, de point de vu locuteur ; car il
s’agit d’un discours divin, dont l’Auteur est Allah, l’Absolument Sincère.
Néanmoins, ce même discours peut être malheureusement malheureux de point de
vu récepteur : l’homme reçoit quotidiennement des versets coraniques et
n’ en croit absolument pas. Ainsi, si le coran
ordonne, l’ordre est un acte illocutoire performatif, de faire le bien
et de bouder le mal, l’homme égaré n’applique pas les
exigences d’un tel ordre, et par fois même il applique des lois
qu’il a lui même posées, lesquelles sont certes bénéfiques pour lui mais
injustes pour d’autres… C’est le même principe pour tout énoncé
de quelque nature qu’il soit, peut importe la classification précédemment
citée. Celle-ci est en effet provisoire vu la généralisation à laquelle on
procédera ultérieurement. Or le message est
souvent sujet de tractations diverses, et son contenu peut être de ce fait
confirmé par le destinateur mais démenti par le destinataire par exemple. Ici
se pose la problématique de la vérité au sein du discours énoncé :
« l’intégration de la problématique de la vérité à l’intérieur
du discours énoncé peut être interprétée d’abord comme l’inscription(
et la lecture) des marques de la véridiction, grâce auxquelles le discours-énoncé
s’affiche comme vrai au faux »( cf.: Algirdas Julien Greimas et
Joseph Courtés.1993 : 417) « Le croire-vrai de l’énonciateur,
ajoute A.J.Greimas, ne suffit pas à la transmission de la vérité : l’énonciateur
a beau dire qu’il « sait »,
qu’il est « certain », que c’est « évident », il
n’est pas assuré pour autant d’être cru par l’énonciataire » (Ibidem
:417) La problématique
de la vérité posée, A.J.Greimas la reformule en disant : « L’énonciateur
n’est plus censé produire des discours vrais , mais des discours produisant
un effet de sens « vérité » : de ce point de vue, la
production de la vérité correspond à l’exercice d’un faire cognitif
particulier(faire paraître vrai ou faire persuasif » (Ibidem :418) Enfin,
Greimas représente le faire persuasif comme coordonné à un faire interprétatif
pratiqué par l’énonciataire pour une éventuelle rétorque. Pour
illustrer encore plus cette thèse de Greimas on donne l’exemple suivant :un
locuteur pourrait dire : « je dis que la Terre est ronde »
et le récepteur rétorque : « je ne crois pas que la Terre
soit ronde, mais je dis qu’elle n’est pas parfaitement ronde ». Dans
ce cas, le message a été bien reçu et compris par le destinataire , toutefois
il n’a pas été ratifié par ce dernier ; encore plus il a été remis
en cause , et a été, de ce fait, substitué par un autre massage.
C’est-à-dire, le référent du premier message n’est pas, selon le
destinataire, une réalité et il est ainsi réputé malheureux. La
thèse de Greimas est applicable à haut degré pour un discours humain ,et
appelle d’un autre côté à une réévaluation du schéma de Jakobson en
communication linguistique
.Néanmoins cette thèse ne saurait s’appliquer lorsqu’il s’agit
d’un discours sacré tel le discours coranique : la vérité dans un tel
discours est parfaite étant donné que c’est un texte divin, dont les
subtilités et les nuances sémantiques ne peuvent nullement être épuisées en
dépit des essayes multipliés d’interprétation que peut déployer l’être
humain. Bref, qu’il
s’agisse d’un énoncé informatif ou illocutoire performatif , le principe
en vigueur est le même : le référent de l’énoncé est sa valeur de vérité. Mais comment
doit-il se conduire le traducteur avec l’énoncé ? Le principe
d’objectivité du traducteur, on le croit, est essentiel en traduction .Ainsi,
afin d’être fidèle, le traducteur n’a pas le droit de mentionner une
discussion éventuelle de la véracité ou de la fausseté
du texte à traduire, ou un
jugement de valeur émis à son
sujet, dans le texte d’arrivée. Par
conséquent, si quelqu’un a écrit : « Le Soleil tourne autour de
la Terre » , le traducteur ,lui, il a le droit à interpréter l’énoncé
en phase d’analyse ; mais il ne peut pas prendre un jugement
à travers lequel cette énoncé se trouve falsifié dans la production. L’énoncé
doit donc être décodé comme suit : « Une grande étoile, le
Soleil, effectue un mouvement circulaire ou elliptique autour d’une planète,
la Terre » et le référent de l’énoncé sera un acte illocutoire de la
forme : « Le locuteur affirme que le Soleil tourne autour de la Terre ». Mais il faut absolument
que soit mentionnée la référence en bas de l’énoncé, par exemple dans ce
cas un individu qui a vécu à l’époque médiévale…
NOUREDDINE HALI
|
|
Envoyez un courrier électronique à halitraduire@yahoo.frpour toute question ou remarque concernant ce site
Web.
|