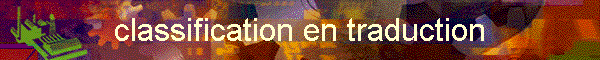

|
|
|
ici un ouvrage en traductologie Chapitre1 repérage linguistique coordonnées d'un élément linguistique remarques importantes chapitre2 définition préliminaire traduction encodage-décodage définition sémiotique de traduction classifications en traduction chapitre3 équations en traduction : équation syntagmatique équation paradigmatique équation sémantique équation temporelle . La société et choix des mots chapitre4 Le terme métatraduction : un néologisme née au Maroc en 2003 chapitre7 Exercices en traduction : une vingtaine de modèles parfaitement ajustés à notre théorie Introduction à la partie pratique des fondements théoriques مــــقدمـــة الجزء التطبيقي من الأسس النظرية للترجمة العلمية Unités syntagmatiques simples وحدات تركيبية بسيطة Unités syntagmatiques complexesوحدات تركيبية مركبة Textes scientifiques vulgariséesنصوص علمية معممة Textes généraux:traductions sans commentaires : ترجمة دون تعلـــــيق نصـــــــــــــوص عــــامـــة
|
III-
Classification Jakobsonienne de Traduction et traduction à base de repérage
Linguistique
1-
Classification
Jakobsonienne de traduction « Pour
le linguiste comme pour l’usager ordinaire du langage, le sens d’un mot
n’est rien d’autre que sa traduction par un autre signe qui peut lui être
substitué , spécialement par un autre signe « dans lequel il se trouve
complètement développé »comme l’enseigne Pierce » (cf.
R.Jakobson 1963 : 79). Le
mot « célibataire » peut être ainsi converti en une désignation
plus explicite(expression définitionnelle ) ,personne non mariée ;
on peut de même substitué au mot « fromage » une expression définitionnelle
ayant un plus haut degré de clarté :aliment obtenu par fermentation du
lait caillé . Après avoir
exposé ces deux exemples empruntés respectivement à Pierce
et B.Russel):
cf. ibidem :(79,
R.Jackobson a catégorisé la
traduction en trois classes : -La
traduction intralinguale ou reformulation, qui consiste en l’interprétation
des signes linguistiques au moyen d’autres signes de la même langue . -La
traduction interlinguale ou traduction proprement dite, qui consiste en
l’interprétation des signes
linguistiques au moyen d’autres signes d’une autre langue. -La
traduction intersémiotique ou transmutation , qui consiste en l’interprétation
des signes linguistiques au moyen de systèmes de signes non linguistiques.
2-
Classification Jakobsonienne de traduction et traduction à base de repérage
Linguistique :
A-Traduction intralinguale :
La traduction intralinguale comme conçue par R.Jackobson n’est en réalité
qu’une transformation paraphrastique telle celle présentée par Z.Harris .
Pour rendre compte des exigences imposées par cette transformation, on procédera
à un légère changement au niveau des expressions équivalentes au deux termes
« célibataire » et « fromage » ; lesquelles seront
remplacées par deux énoncés définitionnels : le célibataire est une
personne non mariée et Le fromage est un aliment
obtenu par fermentation de lait caillé. Il
est certain que le mot « célibataire » et l’énoncé « le célibataire
est une personne non mariée » ont la même coordonnée sémantique , mais
ils sont dissemblables de point de vue degré d’analyse ou profondeur sémantique.
On peut dire généralement que le lexème et son énoncé définitionnel ont la
même coordonnée sémantique, mais deux degrés d’analyse différents :
on affectera théoriquement le lexème d’un degré d’analyse standard ;
un tel degré doit être objet d’un éventuel consensus entre les individus
d’une même communauté linguistique. Quant à l’énoncé définitionnel, ou
définition tout cour, il sera affecté d’un degré d’analyse évolué vis-à-vis
du degré standard : il s’agit d’un plan sémantique ayant une
graduation strictement positive selon l’axe sémantique. En outre, le degré
d’analyse est fonction du degré de compréhension chez le destinataire :
si un spécialiste en informatique industrielle perçoit le mot « ordinateur »,
lui qui appréhende parfaitement les sèmes constitutifs de cet appareil , il
pourrait à coup sûr concevoir une définition très exhaustive d’un
ordinateur ; alors qu’un individu ne possédant pas suffisamment
d’informations en électronique ne dirait presque rien en recevant le lexème
« transistor », ceci car la majorité des sèmes
se rapportant à cette composante électronique est méconnue pour lui. Ce
que R.Jackobson appelle traduction intralinguale est intimement lié à la
notion de paraphrase, dont l’origine trouve un embranchement en rhétorique.
Cette notion est en usage excessif en linguistique et elle est appliquée en
lexicologie : le mot est généralement défini dans le dictionnaire par un
ensemble de paraphrases synonymes du mot. Chaque paraphrase est fonction d’un
sème particulier lié à un contexte donné.
Que l’on applique maintenant les principes de traduction à base du repérage
linguistique : -
Les coordonnées du lexème « célibataire » dans le repère
linguistique français sont : Sax1=
0 Say1=
célibataire Se’1=
le sens sémantique du terme -
L’énoncé définitionnel aura pour coordonnées : Sax2=
S+Ve+Att. Say2=
célibataire + personne + mariée … Se’2=
Le sens sémantique de l’énoncé.
On remarque tout de suite les rapports suivants : Sax1≠
Sax2 et Say1≠ Say2 Se’1
=
Se’2
Donc,
nous sommes effectivement en
question d’un type particulier de traduction qui est parfaitement soumis au
exigences théoriques de la traduction comme elles sont exposées dans cet
ouvrage : traduction comme conservation de la coordonnée sémantique(
Se’1 =
Se’2),
et comme transformation des deux coordonnées syntagmatique et paradigmatique.
Toutefois, la transformation de la coordonnée paradigmatique n’est pas totale
mais seulement partielle, et l’équivalence de la coordonnée sémantique est
,dans ce cas, très relative étant
donné que les deux coordonnées , a-t-on dit, diffèrent de point de vue degré
d’analyse, et diffèrent également selon les données contextuelles : un
locuteur traducteur peut ,en effet, traduire le mot « jubn » par l’énoncé arabe « al jubno
ĥālatun inhizāmiya » au lieu de l’énoncé « al
jubno ghiđā’on
yatimmu’alĥuŠūlo ‘alayhi bitakhmīri’alĥalībi’almukhattari »,
la même remarque peut être faite pour tout les lexèmes ayant le sens variable
en fonction du contexte.
Bien qu’elle
soit soumise aux exigences de la traduction à base
du repérage
linguistique, la traduction dite intralinguale n’ acquiesce pas aux conditions
objectives que doit vérifier la traduction, telle la fidélité… Il
ne faut pas oublier en outre que l’admission conventionnelle de ce type de
traduction met le traducteur dans une situation où il serait incapable de
percevoir nettement
la frontière
entre la phase de compréhension et la phase de traduction proprement
dite. Peut-être
serait-ce la raison pour laquelle R.Jackobson qualifie la traduction
interlinguale de traduction proprement dite ;chose qui laisse entendre que
la traduction intralinguale n’est pas réputée traduction proprement dite.
Maintenant, la traduction intralinguale se
soumet-elle à la deuxième définition qui considère la traduction comme décodage-encodage ?
D’abord, nous sommes ici
contraint de considérer le mot « interprétation »constaté
dans la définition de R.Jackobson pour la traduction intralinguale, comme équivalent
au décodage du signe linguistique d’origine d’une part, et son encodage
dans la même langue d’autre part. Aussi semble-t-il ,à
première vue , que la notion de traduction intralinguale soit parfaitement
conforme à la notion décodage-encodage ; en revanche, si on suppose que
l’interprétateur, le signe étant décodé et encodé dans la même langue,
veuille ,à nouveau, décoder le signe précédemment encodé et l’encoder
ensuite mais dans une langue seconde autre que la langue d’origine( traduction
iterlinguale), avons-nous pas le
droit dans ce cas de voir la traduction intralinguale comme une pure et simple
phase de traduction interlinguale (traduction proprement dite), disant la
phase de compréhension du signe de départ ? La
traduction dite « intralinguale » n’est en réalité qu’une
phase de la traduction proprement dite, il s’agit naturellement de la phase de
faire évoluer le degré analytique du signe linguistique de départ( texte
source) de sa position standard à une coordonnée encore plus évoluée, chose
conforme, prétend-on , avec la notion d’interprétation remarquée chez
R.Jackobson.
B-Traduction interlinguale :
C’est le vrai type de traduction, mais de
nombreux points dans la définition qu’a proposée R.Jackobson pour ce type de
traduction attirent particulièrement notre attention et suggèrent que soient
posées les questions que suivantes : Que veut-il dire Jackobson par « interprétation des signes linguistiques » ? Le texte selon Jackobson est-il un assemblage quantitatif des signes linguistiques ? Considère-t-il par suite le référent d’un énoncé comme assemblage quantitatif des référents des signes minimaux constitutifs de cet énoncé ? Ou le texte selon lui est un signe unique ayant deux faces : signifiante et signifiée ? Ou ,comme pour les intertextualistes, un signe sous-tendant plusieurs autres signes(autres textes) ? En
tout état de cause, nous n’avons pas ici l’intention d’entamer un débat
dans ce cadre, quoique important qu’il soit. Mais on doit tout de même
enregistrer une réserve quant à l’usage du terme « interprétation ».
Certes le traducteur fait appel à l’interprétation au cours de la
première phase de traduction en vue de mieux comprendre
le texte de départ, mais il ne doit pas du tout traduire les résultats
de cette analyse. En effet, le traducteur n’a pas le droit d’émettre des
jugements de valeur au sujet du texte de départ en les mentionnant sur le texte
traduit, à l’exception d’éventuels commentaires enregistrés sous forme
d’hypertextes pris en charge par le traducteur qui en assume toute
responsabilité(méthode contrastive). La phase d’interprétation du signe
« fromage » serait ainsi la production d’un énoncé explicatif :
« Le fromage est un aliment obtenu par fermentation du lait caillé »
, mais cet énoncé n’est pas le seul car l’analyse sémique du mot « fromage »
ne comporte pas seulement le sème hypéronymique « aliment » et
celui productif « par fermentation… » : d’autres sèmes
peuvent être pris en considération comme les sèmes constitutifs par exemple.
Ainsi, on peut dire « le fromage est un aliment
très riche en calcium et en vitamine A… ». La phase de
traduction serait l’établissement de l’équivalence « fromage =
aljubn » et non pas la traduction « al jubno ghiđā’on
yatimmu’alĥuŠūlo ‘alayhi bitakhmīri’alĥalībi’almukhattari ».
C-Traduction
intersémiotique : De la valeur sémantique
du préfixe « inter » ,on peut supposer que la traduction intersémiotique
s’effectue entre deux sémiotiques. Or la sémiotique, on le sait déjà, est
un système de signes, qu’ils soient linguistiques , appartenant à une langue
naturelle donnée, ou non linguistiques comme les mimiques, etc. Plus loin
encore, les langues naturelles, comme l’enseigne L.Hjlemstev , sont des sémiotiques
naturelles et les mondes extralinguistiques sont des sémiotiques artificielles.
A.J.Greimas les considère comme des macro-sémiotiques pouvant toujours être
sujet de prolifération de sémiotiques particulières : phonèmes, morphèmes,
noms propres, noms communs , verbes transitifs, verbes intransitifs,
anaphoriques, déictiques, embrayeurs, connecteurs logiques, termes
scientifiques , textes… D’après cette
analyse, on peut dire que toutes les classes traductiques qu’a citées
R.Jackobson gravitent autour d’une et une seule classe, à savoir la
traduction intersémiotique :si on intègre les signes de départ dans une
sémiotique et les énoncés
explicatifs dans une autre, on
s’apercevra que la traduction
intralinguale est intersémiotique . Même chose pour la traduction
interlinguale : le texte de départ ainsi que le texte d’arrivé,
sont deux sémiotiques .
En résumé : Il y a un et un seul type de traduction : la
traduction intersémiotique, tel qu’il y a un est un seul critère de validité
de l’opération traduisante :l’équivalence entre la valeur sémantique
de la sémiotique origine(texte origine par exemple) et celle de la sémiotique
cible (texte cible par exemple). Quant aux propos :traduction littérale,
traduction interprétative, interprétariat, traduction automatique, traduction
pédagogique, traduction professionnelle, traduction mot-à-mot …, ils sont
des mécanismes rhétoriques fonction
des contextes linguistiques et socioculturels et des objectifs pragmatiques des
institutions et des appareils idéologiques visant le passage et la
communication des contenus sémantiques discursifs, qui doivent
être assimilés par les destinataires…
NB :
*Tout usage, de quelque nature qu’il soit , partiel ou total, de cette
présente page web nécessite absolument que soit mentionnée
la référence suivante : NOUREDDINE
HALI : Fondements théoriques de traduction scientifique étude inspirée
de linguistique contemporaine . page traduite de la version arabe éditée à
Rabat au Maroc en février 2003 (Imprimerie Top Press, 22,Rue Kalkuta Hay l’océan-Rabat
tél :037733121 – Eax :037263928 – E-mail :toppress@wanado.net.ma.
*Vos remarques et détails à :
Avec mes remerciements les plus sincères !! |
|
Envoyez un courrier électronique à halitraduire@yahoo.frpour toute question ou remarque concernant ce site
Web.
|