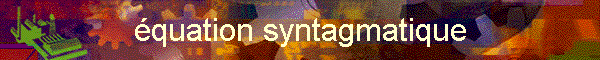
|
|
|
ici un ouvrage en traductologie Chapitre1 repérage linguistique coordonnées d'un élément linguistique remarques importantes chapitre2 définition préliminaire traduction encodage-décodage définition sémiotique de traduction classifications en traduction chapitre3 équations en traduction : équation syntagmatique équation paradigmatique équation sémantique équation temporelle . La société et choix des mots chapitre4 Le terme métatraduction : un néologisme née au Maroc en 2003 chapitre7 Exercices en traduction : une vingtaine de modèles parfaitement ajustés à notre théorie Introduction à la partie pratique des fondements théoriques مــــقدمـــة الجزء التطبيقي من الأسس النظرية للترجمة العلمية Unités syntagmatiques simples وحدات تركيبية بسيطة Unités syntagmatiques complexesوحدات تركيبية مركبة Textes scientifiques vulgariséesنصوص علمية معممة Textes généraux:traductions sans commentaires : ترجمة دون تعلـــــيق نصـــــــــــــوص عــــامـــة
|
1-
Etablissement
de l’équation syntagmatique : Avant
d’entamer quelques principales équations syntagmatiques, voyons tout
d’abord quelques particularités
structurales caractérisant la langue arabe et la langue française. La langue arabe est généralement caractérisée
par deux types de phrases : la phrase verbale de coordonnée
syntagmatique générale :
, dans cette structure, le verbe joue le rôle
de prédicat, et la phrase nominale de coordonnée syntagmatique générale :
Dans ce cas, le sujet ou plus précisément
l’inchoatif ( al mubtada’) aurait pour fonction dans la structure prédicative :sujet ;
alors que l’attribut (al khabar)serait un prédicat. Ainsi, la phrase verbale
arabe aurait pour structure de prédication, dans cet ordre : Prédicat +
Sujet ; quant à la phrase nominale, elle serait représentée par la
structure suivante : Sujet + Prédicat . Toutefois, ces ordres ne sont
admis que s’il s’agit de l’ordre le
plus naturel de la langue arabe, on peut, en effet, pour des raisons
stylistiques et/ou rhétoriques, inverser cet ordre ou cet autre . Ces cas de
bouleversement des structures sont bien précisés dans différentes références
en métalangage arabe .
Il importe de noter qu’il ya d’autres types de phrases annexes à la
phrase nominale: les phrases nominales « transformées »(1[h1])
, soit par des particules ( inna et ses semblables), soit par des verbes défectifs ( kāna
et ses semblables) :dans le premier cas, on obtient une phrase dont la
coordonnée syntagmatique est de la forme : Particule restructurante (inna…)
+1ier syntagme restructuré(2[h2])
+ 2ème syntagme restructuré ; dans le deuxième cas, on aurait
affaire à une structure de la forme : verbe restructurant( kāna…)+1ier
syntagme restructuré+ 2ème syntagme restructuré .
On cite également , parmi
les phrases transformées, la phrase à verbe d’opinion (jumlat
af ‘āl al kulūb)
introduite par (żanna …). Cette
phrase à pour structure générale : Particule restructurante(verbe
d’opinion) + sujet + 1ier syntagme restructuré + 2ème
syntagme restructuré ; à noter que les syntagmes structurés sont
des COD . En
langue française , la phrase nominale n’existe pas : on parle
exclusivement de la phrase verbale de coordonnée syntagmatique générale : S +Va +C ou S+Ve+Att . Le
sujet , on le constate, occupe toujours la tête de la phrase . C’est un véritable
président , non pas qu’il soit placé en tête mais par ce qu’il préside
les échanges sémiques avec ses coéquipiers dans la phrase. C’est donc le
noyau sémique de la phrase, et même son noyau « actif ». La structure prédicative de
la langue française : Sujet
+ Prédicat . Une chose extrêmement
importante devrait être signalée : la relativité des équations
syntagmatiques qui seront proposées prochainement . Elles sont relatives étant
donné qu’un contenu sémantique donné peut être rendu par diverses
structures dans le cadre d’une même langue. Les deux énoncés suivants :
« Ahmed a acheté une voiture de Mohamed
» et « Mohamed a vendu une voiture à Ahmed »
ont en effet le même sens, mais effectivement
avec des nuances sémantiques très fines . Ceci est dû en fait au phénomène
de réciprocité liant les deux unités lexicales : « acheter »
et « vendre » . D’ailleurs le verbe « acheter » présuppose
le verbe « vendre » et réciproquement
le verbe « vendre » présuppose le verbe « acheter »
. On dirait, en passant d’un
niveau linguistique structuraliste s’occupant des unités lexicales à un
niveau linguistique textuel, que les deux énoncés précédemment cités sont réciproques.
De même les deux énoncés : 1-
Il fait nuit 2-
Il ne fait pas jour ; sont pratiquement équivalents
et ont pour cela
Afin de consolider cet
important concept linguistique on ajoute cet exemple d’illustration : 1-
Ce corps est rouge 2-
Ce corps n’est pas vert On s’aperçoit d’emblée
que les deux énoncés n’ont pas la même valeur sémantique car ils ne sont
pas complémentaires étant donné que les deux unités « rouge » et
« vert » ne le sont
pas. En effet, La négation de
« vert » n’implique pas nécessairement « rouge » :
si le corps n’est pas vert il ne sera pas forcément rouge et peut être bleu ou jaune ou violet ou blanc ou
orange… (4[h4]) Donc, dans le cadre
d’une même langue , il y a présence de structures différentes mais ayant la
même valeur sémantique . Ce phénomène sera maintenu dans le cas de deux
langues distinctes et sera même renforcé d’avantage. Un énoncé comme
« l’aimant attire le fer » est rendu en Arabe de plusieurs façons : "
íÌÐÈ ÇáãÛäÇØíÓ ÇáÍÏíÏ "
" íØÈÞ ÇáãÛäÇØíÓ ÞæÉ Úáì ÇáÍÏíÏ " íõÌúÐÈ
ÇáÍÏíÏ ÈÇáãÛäÇØíÓ "" " ÇáãÛäÇØíÓ íÌÐÈ ÇáÍÏíÏ " " Åä
ÇáãÛäÇØíÓ íÌÐÈ ÇáÍÏíÏ " La coordonnée
syntagmatique de la phrase originale est S.+ V. + C.O.D (5)et [h5]les
coordonnées syntagmatiques des phrases traduisant la phrase originale sont
respectivement :
Ý. + ÝÇ. + ã Èå ã. Ý. + ÝÇ. + ã Èå ã +
Ù. ã. Ý. ãÜ. ãÜ + äÇ. ÝÇ. + Ù. Êæ. ã. + Î äÇ.ÍÜ + ÇÓ. + ÎÈ Mais
laquelle, parmi ces cinq structures , constituerait le deuxième membre de l’équation
syntagmatique à côté de la structure originale ? Dans
notre cas on choisirait la structure à laquelle les linguistes arabes ont
accordé la priorité au dépens des autres structures :c’est la phrase
commençant par un verbe . L’équation obtenue sera dite équation
syntagmatique primaire :
Les
autres équations seront appelées secondaires . Le
choix de l’équation est parmi les tâches du traducteur : c’est lui le
maître ,il prend des décisions en procédant à des choix convenables et
pertinents, selon les contextes et selon la cohérence et la cohésion
textuelles . Ainsi, s’il constate que l’équation syntagmatique primaire ne
rend pas convenablement le sens, ou qu’elle aboutit à une traduction amorphe
à style défectueux , ou le texte obtenu n’est pas cohérent à cause d’une
distribution incorrecte, il a pleinement droit d’adopter une équation
secondaire . Toutefois
il ne fallait pas croire que le qualificatif « secondaire » laisse
entendre qu’une équation secondaire soit de peu d’importance. En effet,
elle est souvent plus importante que l’équation primaire puisque elle en est
le substitut . On
veut dire, la première chose prise en charge par le traducteur au début de la
manipulation des structures serait de tester l’équation syntagmatique
primaire . c’est cette dernière qui accorderait au traducteur le premier bout
de l’opération traduisante. Mais vu que l’unité de traduction (unité
syntagmatique) se trouve au sein d’un contexte linguistique très varié , et
que le texte est multistructurel ,
il s’avère parfois nécessaire de renoncer à la structure primaire en la
substituant par une structure secondaire plus importante . Dans le cas où la
structure primaire est forte et prend bonne place dans le squelette textuel, ce
n’est même pas la peine de perdre un temps précieux à chercher une amélioration
structurelle introuvable.
Parfois les connecteurs logiques imposent une certaine structure et
interdisent une autre . Que l’on considère par exemple les deux énoncés
suivants : (1): La
chauve-souris n’est pas un oiseau (2): La
chauve-souris possède des ailes L’équation
syntagmatique primaire de l’énoncé (1) est : S. + Ve + attÛ
äÇ.Ý + ÇÓ + ÎÈ Et celle de
l’énoncé (2) est : S.
+ Va
+
CODÛ Ý. + ÝÇ. + ã Èå ã. On
dirait en arabe : áÇ
íÚÊÈÑ ÇáÎÝÇÔ ØÇÆÑÇ (6[h6]) (1) (2) íãÊáß ÇáÎÝÇÔ
ÃÌäÍÉ
En outre, on constate que
les deux énoncés sont liés par le rapport logique d’opposition ; et si
on utilise la préposition « malgré » pour construire une phrase
complexe concessive , la structure de cette phrase ne sera pas nécessairement
une juxtaposition des deux structures précédentes . En conséquence , le lien
logique est l’un des facteurs qui imposent une structure bien précisé . Ceci dit, nous
proposerons maintenant une liste d’équations syntagmatiques primaires , qui,
loin d’être exhaustive, renferme cependant les équations les plus utilisées :
Remarques :
1- Entre dans le cadre de la structure passive toute phrase dont le sujet
réel est inconnu en langue arabe , et dans laquelle ce sujet est remplacé par
le sujet passif(nāib alfā ‘il) qui est était ,à l’origine, complément d’objet direct. Et
entre dans ce cadre également toute phrase française dans laquelle le sujet
est passif étant donné qu’il n’est pas réel , alors que le sujet réel
acquière une fonction de complément d’agent. Mais une autre structure peut être réputée
structure passive ; c’est une structure à laquelle le traducteur doit
faire très attention :il s’agit des phrases contenant une catégorie de
verbes pronominaux dont le sens est voisin du sens du passif. Ces phrases
sont toujours transformables au passif(Sp+Vp). Parmi ces verbes on cite : Se porter ;
S’appeler ;Se
nommer ;Se jouer ;S’employer ; Se vendre… Ainsi la phrase « Cette expression ne s’emploie plus de nos
jours » est équivalente de point de vue sémantique à la phrase «
Cette expression n’est plus employée de nos jours » . On en déduit que
les deux coordonnées suivantes sont équivalentes :
S.+V+CCT
Û Sp+Vp+CCT L’arabisation de la phrase serait : " áã íÚÏ åÐÇ ÇáÊÚííÑ
íõÓÊÚãá ÍÇáíÇ " En principe, la coordonnée syntagmatique équivaut à la structure
« Sp + Vp + CA » est « ãÜ. +
ÎÈ. », tels que le « mubtada’ » est le
« Sp » et le « khabar » est le nom dérivé « Ism’almaf
‘ūl » , nommé parfois improprement « participe passé »,
qui assume la même fonction de son verbe actif. Une
phrase comme « Le fer est attiré par l’aimant » est traduite littéralement
par « ÇáÍÏíÏ ãÌÐæÈ
ÈÇáãÛäÇØíÓ » ; mais cette phrase a subit une
transformation pour devenir une phrase plus élégante et plus originale
« íÌÐÈ
ÇáÍÏíÏ ÈÇáãÛäÇØíÓ » La même
chose se dit à propos de phrases comme : « L’air
est essentiellement constitué d’oxygène et d’azote » La traduction mot à mot est
« ÇáåæÇÁ ãõÔßøá
ÃÓÇÓÇ ãä ÇáÃæßÓÌíä æÇáÂÒæÊ » ; mais on dit
« íÊÔßá ÇáåæÇÁ
ÃÓÇÓÇ ãä ÇáÃæßÓÌíä æÇáÂÒæÊ ».
Dans cette dernière phrase
arabe, on remarque que le verbe qui a remplacer « Ism ‘almaf’ūl »
est actif et il est devenu ainsi par un ajout de la lette « t ».
Le verbe original est en effet « Ôóßá Ü íõÔßá ». La lettre « t » ajouté sera ainsi une entité arabe
permettant de transformer une structure passive en structure active :il
s’agit ici d’une spécificité à la langue arabe en vertu de laquelle une
simple entité « ĥarf » acquiert des
fonctions très sensibles dans les discours linguistiques telles la cohérence
et la cohésion textuelles par exemple(connecteurs logiques…). A signaler qu’il existe
d’autres verbes arabes qui subissent le même sort : ßóæøóäó Ü íõßæøöäõ
Ü íóÊóßóæøóä (Êóßóæøóäó)¡ Ü ÑóßøóÈ Ü
íõÑóßøöÈ Ü íÊóÑßøóÈ (ÊóÑßøóÈ) Ü ÌäøøóÏ Ü
íõÌóäøöÏ Ü íÊóÌóäøóÏ (ÊóÌóäøóÏ.... 2- La coordonnée « S.+
V(avoir) + C.O.D », membre de la septième
équation syntagmatique, pourrait avoir pour image la structure arabe
« Ý
(ÇãÊáß) + ÝÇ. + ã Èå ã »
qui demeure moins répandue que la structure « ÎÈ. ãÞÏã + ãÜ. ãÄÎÑ »
. Ainsi, la phrase « Ahmed a un livre très intéressant» peut être
traduite par l’une des phrases : « íãÊáß ÃÍãÏ ßÊÇÈÇ ÈÇáÛ ÇáÃåãíÉ » ou « áÏì
ÃÍãÏ ßÊÇÈ ÈÇáÛ ÇáÃåãíÉ » ou
« áÃÍãÏ ßÊÇÈ ÈÇáÛ
ÇáÃåãíÉ » ou « ÚäÏ ÃÍãÏ ßÊÇÈ ÈÇáÛ ÇáÃåãíÉ » . Mais le traducteur , on se le
rappelle, peut se contenter de l’équation primaire ou la surpasser s’il
croit que l’équation secondaire apporte une valeur ajoutée au texte
d’arrivée telles de l’innovation , de l’originalité, de l’esthétique
,de la fidélité … 3-
La
structure constatée dans la huitième équation sera amplement
détaillée dans le cinquième chapitre de la partie théorique ;
cette structure , nommé structure modale, acquière une importance particulière
dans toutes le langues naturelles : c’est une structure inhérente à
tout discours de quelque nature qu’il soit, et nul locuteur ne peut s’en
passer . 4-
Le complément
d’agent de la troisième équation n’est pas rendu en Arabe ; Joseph.N.Najjar a illustré les causes de cette élision : §
On ne
peut pas le déterminer car il est inconnu(Le domicile a été volé) §
Ce
n’est pas la peine de le citer car il est très connu (ÎáÞ ÇáÅäÓÇä ÖÚíÝÇ Ü ÞÑÂä ßÑíã) §
On désire le dissimuler pour qu’il demeure ambigu (Le cheval a été
monté) (ÑßÈ
ÇáÍÕÇä) §
De crainte qu’il soit connu ou pour ne pas l’atteindre en sa dignité
(Quelqu’un a été frappé)
(ÖÑÈ ÝáÇä) §
Peut
importe qu’il soit cité (ÅÐÇ
ÍííÊã ÈÊÍíÉ ÝÍíæÇ ÈÃÍÓä ãäåÇ Ãæ ÑÏæåÇ Ü ÞÑÂä
ßÑíã)
(Cf : Joseph.N.Najjar 48 Ü 199147 pp )
M.Najjar propose ensuite une traduction pour la structure du verbe passif
en disant : « …On trouve une solution pour ce problème par
usage de la structure active , et ce selon deux modalités : -
ÝÊÍ ÇáÎÇÏã
ÇáÈÇÈ (La
porte fut ouverte par le serviteur) -
ÇáÈÇÈ ÝÊÍå
ÇáÎÇÏã (Arabisation plus correcte)
Quant à la phrase « ÇáÈÇÈ ÝõÊöÍ ãä ÇáÎÇÏã » , elle est inadmissible en langue arabe car sa structure paraît
un peu bizarre » (Ibidem p :48)
M.Najjar s’est basé sur une équation syntagmatique secondaire au
cours de la traduction de la structure du verbe passif . Il s’est appuyé en
effet la première et la quatrième équations. Mais il a, constate-t-on ,
favorisé la phrase nominale comme le cas où la coordonnée syntagmatique de la
phrase française est ( S.+ Ve + Att ) dont l’équivalent est par
exemple (ã. + ÎÈ.) . Or une telle coordonnée n’est pas valable , et doit être ,par voie de conséquence ,remplacée par (Sp+
Vp + C.A) . Mais la traduction de Joseph
reste admise étant donné qu’ une équivalence sémantique relative s’y
trouve bel et bien présente . Certes la traduction « ÇáÈÇÈ ÝÊÍ ãä ÇáÎÇÏã » n’est pas
valable. Mais que dit-on au sujet d’une phrase structurée comme suit :
« ÝõÊöÍ ÇáÈÇÈ ãä áÏä ÇáÎÇÏã » ? N’est-elle pas une structure valable ?Cette même
tournure est parfois remplacée par une autre encore plus déformée :
« ÝÊÍ
ÇáÈÇÈ ãä ØÑÝ ÇáÎÇÏã »,
mais très répandue . Or toute structure répandue est ,de point de vue
pragmatique, approuvée par la communauté linguistique (société) et, en vérité,
mieux une erreur répandue qu’une vérité restreinte ! Bref, le
passif en Arabe , comme en Français, est
un style ayant des spécificités structurales pouvant rendre le texte
rhétoriquement plus élégant. Chose qui, parfois ,n’est pas offerte
par la voie active . En outre, On ne doit pas hésiter
d’utiliser l’expression arabe « ãä
áÏä » car c’est une
expression coranique originale.
5-Essentiels , fondamentaux et nécessaires sont les concepts liés aux
équations syntagmatiques primaires et secondaires . Ils constituent
en effet une issue scientifique plausible conduisant à la généralisation
de nos fondements théoriques à diverses
formes et typologies textuelles du scientifique au poétique … Le but est la
consolidation de ces concepts et la finalité serait une certaine « rétorque »
au linguiste français Oswald Ducrot : Survolons
d’abord brièvement et fidèlement quelques attitudes d’O.Ducrot en se référant
à son ouvrage « Structuralisme en linguistique » édité à Paris
en 1968 : « …L’ordre linéaire des mots dans la phrase est censé
imiter la succession naturelle des idées dans l’esprit : le sujet se met
au début de la proposition parce qu’on doit considérer la chose qui jugée
avant de porter sur elle un jugement . » (Cf. O.Ducrot
1968 p :19) « …Bien sûr,
les phrases ne sont pas construites de façon identique dans toutes les langues
, et même dans une langue donnée on trouve beaucoup de constructions différentes…Mais
cette diversité provient de transformations opérées par la langue elle-même
à partir d’un schéma initial(7)
[h7] , qui respecte ,lui, la nature de la pensée.
Les énoncés déviants , même lorsqu’ils sont nombreux, voire majoritaires ,
dérivent d’énoncés normaux sous-entendus. Pour les comprendre , pour faire
leur construction, il faut opérer à rebours les transformations dont ils sont
issus(Ibidem p :20) . « …L’ordre habituel en
français étant considéré comme « naturel ». On suggère par là
que les phrases allemandes où le verbe précède le sujet ne constituent pas
une donnée initiale , mais qu’elles ont été obtenues par permutation à
partir d’un énoncé implicite où le sujet avait la priorité qu’il mérite.
Pour les décrire il faut sec référer aux phrases normales qui les
sous-tendent , et indiquer les « inversions » qui produisent les
premières à partir des secondes. »(Ibidem p :20) Ensuite, O.Ducrot décrit la langue française comme établir une certaine suprématie
vis-à-vis de la langue allemande : dans la première, les phrases sont
ajustées conformément à l’ordre logique et naturel ; tandis que dans
la deuxième , elles ne le sont pas. Au bout de son commentaire, O.Ducrot
aboutit au jugement de valeur : « Le seul ordre possible entre les
mots , c’est l’ordre des choses, et tout le reste est désordre. »(Ibidem
p :21). D’emblée, Ducrot considère la
coordonnée syntagmatique (S. + V.) en Français comme une
structure en parfait accord avec l’enchaînement naturel de la pensée ;
elle est ainsi une structure primaire applicable à toute langue naturelle ,
l’Allemand et l’Arabe incluses . La preuve c’est que cette structure soit
la base d’un processus logique basé à son tour sur la catégorie : Sujet+Prédicat.
Ceci est-il vrai pour la langue arabe ? Le système structurel de la langue
arabe peut être considéré comme bistructurel : c’est-à-dire basé sur
deux structures distinctes, la structure nominale et la structure verbale(ã. +
ÎÈ. /
Ý. + ÝÇ.) Il paraît dès le début que la première structure soit parfaitement cohérente avec la conception Ducronniène. Effectivement, elle reflète cette enchaînement logique de la pensée , réalité qui fut déclarée par les grammairiens arabes il y a si longtemps ! Il ont en effet affirmé qu’il était impossible d’accorder un attribut à quelqu’un d’inconnu, si bien que le sujet (almubtada’) bénéficie toujours d’une détermination ,car il est illogique qu’il soit purement indéfini (8[h8]) A ne pas oublier que le verbe dans la phrase nominale
arabe n’existe pas , alors qu’il apparaît en français sous forme d’un verbe exprimant l’état psychique ,
social ou culturel… du sujet d’attribution , nommé verbe d’état La deuxième structure arabe coïncide de point de vue ordre avec la structure allemande. Cette structure arabe originale peut-elle être qualifiée de déviante , et qui, par voie de conséquence , a besoin d’être transformée pour rejoindre la structure française originale et naturelle ?! La langue est un phénomène social ;elle est caractérisée par son propre génie . La société pratiquant la langue française comme langue maternelle n’est point la société ayant pour langue maternelle la langue arabe. Les valeurs sociales , universelles, religieuses, psychiques, spirituelles, intellectuelles…ne sont pas les mêmes dans les deux sociétés … Le génie de la langue française n’est pas celui de la langue arabe. Ne vois-tu pas comment l’ossature originale pour tous les gens est la même , et ce squelette ne peut jamais se généraliser sur toutes les espèces animales ? Chaque langue a ses propres structures originales et naturelles et ce sont justement les locuteurs qui transforment de ces structures en faisant des ajustements pour mieux gérer les diverses situations de communication . Je vois que la structure arabe « V+S » ( Ý. + ÝÇ.) est pertinente , surtout au niveau pragmatique. Quiconque ne s’opposera au fait que l’objectif ultime du locuteur soit de persuader et de vaincre son interlocuteur . En effet, un locuteur incapable de déclencher un lien communicatif avec ses interlocuteurs est sans aucun doute un locuteur défaillant . Parmi les méthodes , comme l’enseigne Ducrot lui-même , pour établir la communication on cite : la création de l’horizon d’attente chez l’auditeur . Si je dis : « rasama… » sans ajouter aucun autre mot, je créerai sûrement chez mon allocutaire un désir de savoir le sujet du dessin (c’est-à-dire celui qui a fait l’action de dessiner), et ce désir c’est l’horizon d’attente. L’allocutaire pourrait ainsi se poser de nombreuses hypothèses telles que, « le peintre a dessiné un tableau » , « l’enfant a dessiné un arbre », « l’architecte a dessiné un plan »…Il fait donc des entraînements structuraux très rentables . Ce n’est pas le cas à cent pour cent avec la structure
nominale « ã.
+
ÎÈ » Si on dit : « Ahmed… » et on s’arrête, l’horizon sera trop vaste pour que l’allocutaire puisse se proposer une hypothèse qui soit envisageable. Pour conclure, chaque langue est marquée par une (ou plusieurs) structure réputée structure naturelle vu son accessibilité aux locuteurs , cette structure qui peut être, à tout moment, transformée pour motifs rhétoriques, stylistiques, énonciatifs , sociaux , diachroniques , synchroniques… En mise au point, l’équation syntagmatique primaire est sous la forme :
Où : Sax1 représente la structure syntagmatique
originale du texte de départ et Sax2 représente la structure
syntagmatique équivalente à Sax1 mais
en accord avec les exigences structurelles de la langue cible. Cette équation est
souvent utilisée pour procéder à la traduction littérale devant aboutir à
un texte qui conserve le sens du texte original (9[h9]) L’équation
syntagmatique secondaire est de formule générale :
C’est
une équation de substitution car elle remplace l’équation Sax1Û Sax2 qui ne
parvient pas à établir l’équation sémantique à cause des imperfections
pouvant être rhétoriques, ou dues aux décalages d’usage entre les deux
langues… NB :
*Tout usage, de quelque nature qu’il soit , partiel ou total, de cette
présente page web nécessite absolument que soit mentionnée
la référence suivante : NOUREDDINE
HALI : Fondements théoriques de traduction scientifique étude inspirée
de linguistique contemporaine . page traduite de la version arabe éditée à
Rabat au Maroc en février 2003 (Imprimerie Top Press, 22,Rue Kalkuta Hay l’océan-Rabat
tél :037733121 – Eax :037263928 – E-mail :toppress@wanado.net.ma.
*Vos remarques et détails à :
Avec mes remerciements les plus sincères !!
[h1](1)Il s’agit ici d’une transformation générative :
on parle d’une restructuration de
la phrase .Les
transformations n’affectent pas le sens des phrases de base, c’est-à-dire
le sens de la phrase principale et celui de la phrase restructurée ne
diffèrent que d’une nuance sémantique infime. Les transformations sont
en effet des opérations purement formelles : réarrangement des
constituants de la phrase, substitution et addition.Mais il ne faut
absolument pas oublier que la restructuratiuon change le sens fonctionnel
de la phrase et cette
composante est une partie de la coordonnée sémantique.
[h2](2)Il s’agit là d’un changement de flexion désinentielle
( ,alharaka ,al-i’rabiya ).
[h3](3)
pour plus de détails à ce sujet , on peut se référer aux ouvrages
traitant de la sémiolinguistique , plus particulièrement les recherches
menées dans ce domaine par les linguistes de l’école de Paris
comme A-J-Greimas …
[h4](1)
Un principe général et fondamental doit être mis en évidence ici :
la linguistique est une unité , bien que les gens essaient de la faire
montrer comme étant un ensemble de disciplines parfois contradictoires .
En réalité, il s’agit de niveaux linguistiques complémentaires :
on ne comprend pas en effet comment procéder à une analyse textuelle
dans le cadre d’une linguistique textuelle sans passer par des analyses
componentielles dans le cadre d’une linguistique lexicale structuraliste ?
Le linguiste doit donc être d’abord
généraliste puis spécialiste en un niveau
donné comme distributionnaliste ou générativiste …De point de
vue pragmatique, si un distributionnaliste
comprend le texte comme il faut en faisant recours exclusivement
aux distributions catégorielles, il oublie qu’il fait appel ,
qu’il le désire ou non, à
d’autres critères tels le critère sémantique , lexical…
[h5](5)
Dans cet ouvrage sont utilisées des signes conventionnels qu’on
parvient à décoder en faisant référence au tableau des signes
conventionnels trouvé parmi
les premières pages .
[h6](6)
Le verbe arabe “I’ tabara“ est réputé ici verbe restructurant défectif
à côté de kāna
et ses semblables,
car il se joint au sujet (almubtada ‘) et à
l’attribut(‘alkhabar)pour les restructurer : (ÇáÌæ ÕÍæ- íÚÊÈÑ ÇáÌæ ÕÍæÇ ).
Mais cette attribution n’est pas encore adoptée par la majorité des
grammairiens arabes .
[h7](7)Ducrot
veut dire, on le croit, une structure initiale , ou selon ma présente
terminologie , coordonnée syntagmatique primaire.
[h8](8)Les
grammairiens arabes ont beaucoup dit au sujet de l’ordre dans la phrase ;
et les opinions en ce sujet sont trop nombreuses et diversifiées pour les
inventorier et le épuiser. Même chose pour la question de l’originalité
. Mais , toute tentation faite, c’est pour discuter une opinion d’un
grand linguiste qui est
tributaire d’une très grande capacité de réévalution
de ces travaux en se basant sur le principe d’autocritique .
Cette opinion dans laquelle ,me paraît-il, Ducrot est plus sympathique
envers sa langue maternelle .
[h9](9)Quelque
uns de nos étudiants croient que traduire littéralement c’est mettre
des mots à la place des autres sans se préoccuper de changer des ordres
ni d’ajouter ou de supprimer des mots ou des expressions . Non , c’est
une manière ironique de voir les choses . Par contre, la traduction littérale
est une classe de traduction qui met en fonction des équations
syntagmatiques primaires. |
|
Envoyez un courrier électronique à halitraduire@yahoo.frpour toute question ou remarque concernant ce site
Web.
|